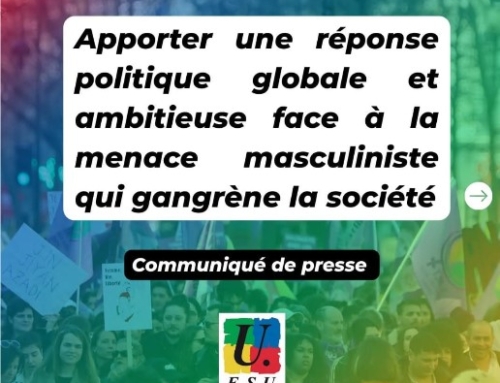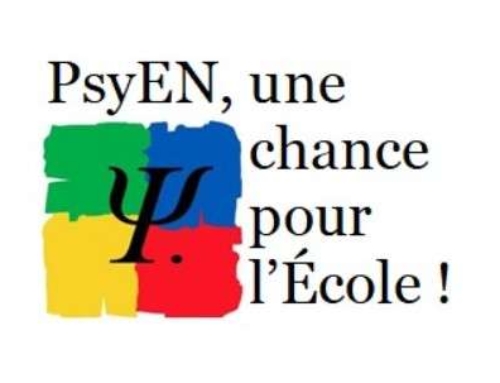Un budget de guerre sociale
Note de la FSU sur le PLF et le PLFSS 2026
Quelques chiffres généraux pour commencer :
• Le PLF 2026 prévoit un déficit public établi à – 4,7 % du PIB, après – 5,4 % en 2025 et – 5,8 % en 2024.
C’est quasiment le même niveau d’effort (30 milliards) que ce que prévoyait le gouvernement Bayrou.
• La hausse de la dépense primaire nette (l’ensemble des dépenses publiques sous contrôle direct du
gouvernement, principal indicateur regardé par l’Union européenne pour juger du respect des règles
budgétaires) sera limitée à 0,6 %, contre 0,7 % annoncée au printemps.
Lecornu évoque un possible relâchement de la cible pouvant aller jusqu’à 5 % du PIB, une marge très
réduite de 9 milliards d’euros.
1. Masquer les effets délétères de la politique « de l’offre »
Le projet de budget 2026 obéît à la même exigence que tous les budgets néolibéraux précédents :
concilier la demande du secteur financier, qui réclame une réduction rapide du déficit pour garantir ses actifs, et celle des grandes entreprises qui, du commerce à l’industrie, réclament la poursuite des aides publiques massives. Concilier ces deux demandes nécessite de réduire le déficit par une contribution croissante du travail et des services publics, tout en maintenant le transfert de fonds de l’État vers le secteur privé (la politique de l’offre).
Ainsi, les 30 milliards d’efforts espérés se composent de :
• 17 milliards d’euros d’économies de dépenses (dont les services publics paient un lourd tribut),
• auxquels s’ajoutent environ 14 milliards d’euros de recettes fiscales (qui pourraient être très largement supérieures si les plus riches étaient mis·es à contribution).
2. Côté dépenses de l’État : haro sur les services publics
Seuls trois postes seront clairement en hausse par rapport à 2025 les dépenses militaires (+ 6,7 milliards d’euros); le prélèvement sur recettes au bénéfice de l’Union européenne (+ 5,7 milliards) ; les intérêts payés sur la dette (+ 8,1 milliards). Comme en 2025 et 2024, gel du point d’indice : l’inflation cumulée depuis 2024 atteindra 4,1 % ! et de toute mesure catégorielle.
-Agences et opérateurs de l’État : 1735 emplois publics sont supprimés. Les saignées sont dans la Culture, la Transition écologique et le Travail, qui cumulent d’importantes suppressions de postes à l’État et parmi les opérateurs et agences.
-Collectivités territoriales
Elles contribuent aussi elles aussi à l’effort. La nouvelle ministre de l’aménagement du territoire et de la
décentralisation annonce que pour les collectivités locales, l’effort demandé sera de 4,7 milliards
d’euros en 2026.
-Culture
Le budget 2026 acte une baisse historique de 170 millions d’euros et grave dans le marbre la
suppression de 171 ETP ainsi qu’une coupe franche dans le budget du patrimoine.
-Éducation
Hors pensions, en euros constants, les crédits sont en baisse :
• – 1,37 % pour le premier degré ;
• – 1,41 % pour le second degré ;
• – 2,86 % pour le programme vie de l’élève.
En neutralisant l’effet « emplois de stagiaires », ce sont 4018 postes d’enseignant·es titulaires qui sont supprimés dès 2026, la plupart dans des écoles et établissements publics : 1891 dans le 1er degré et 1365 dans le 2nd degré publics. L’argument démographique ne tient pas : pour retrouver le taux
d’encadrement de 2017, il faudrait créer des dizaines de milliers d’emplois.
-Enseignement Supérieur et la recherche (ESR)
L’ESR gagne 566 millions d’euros par rapport à 2025, mais sont en retrait de plus de 364 millions par rapport à la loi de finance initiale de 2024 et pour le programme 150, qui progresserait de 157 millions par rapport à la LFI 2025, ce sont plus de 519 millions de dépenses contraintes supplémentaires que les établissements devront assumer en 2026 par rapport à 2025.
-Fonds vert
Après une baisse de 54 % l’année dernière, les autorisations d’engagement de cette enveloppe
indispensable pour la mise en œuvre de la transition écologique sur les territoires chutent à 650
millions d’euros pour 2026 – alors que le Fonds vert était encore doté de 2,5 milliards d’euros en 2024.
-Justice
Si les crédits augmentent, ils sont bien mal orientés ! 3 000 places de prison supplémentaires sont
créées, alors qu’il aurait fallu ventiler ces budgets sur ce qui marche réellement pour prévenir la récidive
d’infractions : l’accompagnement des usager·ères en milieu libre ! Seulement 100 ETP sont créés pour des Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) exsangues alors qu’ils prennent en charge la totalité des usager·ères du service public pénitentiaire (180 000 personnes en milieu ouvert + 85 000 personnes détenues).
A la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le budget stagne (+ 0,36 %, soit moins que l’inflation prévue), 10 % du budget de la PJJ reste alloué à l’enfermement des enfants, avec l’ouverture supplémentaire de 5 CEF et l’annonce d’un nouvel EPM. La volonté d’avoir toujours plus recours aux contractuel·les est sensible, fragilisant toujours plus le statut de fonctionnaire en l’absence d’un plan massif de titularisation de ces dernier·ères.
-Sport, jeunesse et vie associative
Les crédits baissent de 300 millions soit – 20 % (- 21,3 % en euros constants).
3. Hausses d’impôts pour la population, cadeaux fiscaux pour les plus riches et les grandes entreprises. Au total, les PLF et PLFSS 2026 prévoient 29 nouvelles mesures fiscales, mais aucune pour enfin faire rentrer les ultra-riches dans le champ de la solidarité nationale :
-Gel du barème de l’impôt sur le revenu : cela correspond à une hausse d’impôts déguisé (une
hausse du montant et de l’assiette puisqu’elle rendra imposables nouveaux ménages qui ne l’étaient
pas), mais sélective (les classes moyennes sont comparativement plus impactées que les plus riches, en raison de la faible progressivité de l’impôt dans les tranches les plus élevées).
-Gel du barème de la CSG (ce qui aura la même conséquence : les ménages proches du seuil de
déclenchement et qui connaissent une progression de leurs revenus cette année deviendront
redevables de ce prélèvement, alors que cela n’aurait pas été le cas avec le relèvement habituel du
barème).
–Remplacement de l’abattement de 10 % dont bénéficient les retraité·es sur leur pension par un abattement forfaitaire de 2 000 euros (qui conduira à une hausse d’impôts pour beaucoup).
-Suppression de certaines niches fiscales, mais pas de celles qui bénéficient aux plus riches. C’est par exemple l’exemption d’impôt sur les indemnités journalières pour affection longue durée qui est supprimée.
Pour mémoire, depuis 2017, la politique budgétaire inefficace de cadeaux aux grandes entreprises et
aux plus riches, pudiquement intitulée « politique de l’offre », consiste à un effacement des recettes
fiscales, passées selon l’Insee de 54,3 % du PIB en 2017 à 51,4 % en 2024. Les aides publiques aux entreprises atteignent ainsi des sommets et s’élèvent à 211 milliards en 2023 (selon la commission d’enquête du Sénat – 6690 € par seconde !), et même à 270 milliards (selon Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre dans leur livre Hold up !).
Dans le projet de budget 2026, cette politique est poursuivie :
–Les recettes effacées depuis 2017 (avec la suppression de l’ISF, la création de la « flat tax », la
réforme de l’« exit tax », la baisse du taux d’imposition sur les bénéfices des grandes entreprises) ne
sont pas rétablies.
-La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est accélérée
et disparaîtra en 2028, soit deux ans avant la date initiale prévue.
–La surtaxe « temporaire » à l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros est certes reconduite, mais avec un taux divisé par deux soit 4 milliards au lieu de 8 en 2025.
4. Un ersatz de taxe Zucman… qui permettra aux plus riches d’échapper encore à l’impôt
Contrairement à ce que Lecornu essaie de faire croire, l’article instituant cette nouvelle taxe sur
les holdings prévoit une longue liste d’exonérations. Au final, presque toute la richesse détenue dans
les holdings (95 % selon Gabriel Zucman) échappera à cette taxation, qui ne devrait rapporter qu’1 milliard d’euros selon le gouvernement (quelques centaines de millions selon Gabriel Zucman).
5. Côté PLFSS : toujours plus d’économies sur le dos des plus fragiles
Marchant dans les pas de Bayrou, Lecornu propose une année blanche pour toutes les prestations sociales. Cela signifie que les pensions de retraite, le RSA, les allocations familiales, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation aux adultes handicapé·es, la prime d’activité, les aides au logement… seront gelées. Ce gel revient à faire baisser toutes ces prestations sociales en valeur réelle. Plusieurs économistes ont déjà pu simuler ses effets : sans surprise, les plus pauvres seront les principales victimes selon l’Observatoire français des conjonctures économiques et l’Institut des politiques publiques. L’effet récessif de l’année blanche est particulièrement vif pour le gel des prestations sociales (plus fort encore que celui du barème de l’impôt sur le revenu) car celles-ci sont très importantes dans les revenus des plus pauvres.
Parallèlement, l’Objectif gouvernemental de Dépenses d’Assurance Maladie : ONDAM augmente seulement de 1,6 % (alors que l’inflation augmente de 1,3 %), en nette baisse par rapport aux années précédentes. L’ONDAM devrait être à minima à 6 % pour tenir compte des besoins (notamment en raison du vieillissement de la population). Il s’agit-là d’économies « cachées » (environ 7,1 milliards d’euros) qui entraîneront la baisse des financements publics des hôpitaux et des Ehpad, le doublement des franchises médicales, de nouvelles baisses de remboursement des soins et des médicaments. A cela s’ajoutent déjà, pour les fonctionnaires, un jour de carence (non compensé par les mutuelles) et la baisse de 10 % du traitement indiciaire brut en cas de congé maladie ordinaire.
6. « Suspension » de la réforme des retraites
Cette « suspension » n’en est pas une, il ne s’agit que d’un simple décalage, de l’aveu même de Macron : l’âge cible de 64 ans reste inscrit dans la loi et serait atteint en 2033 au lieu de 2032. La durée cible de 172 trimestres serait atteinte en 2029 au lieu de 2028. Dans sa lettre rectificative, le gouvernement prévoit que les carrières longues et certains régimes spéciaux en soient exclus, et que son coût soit essentiellement supporté par les retraité·es actuel·les, via une hausse du taux de contribution des organismes complémentaires (mutuelles, assurances santé…) qui aura pour conséquence l’augmentation des cotisations, et la sous-indexation plus importante des pensions des retraité·es par rapport à l’inflation en 2026 et 2027. Enfin, on peut craindre que les négociations promises à l’occasion de ce décalage ne débouchent sur de nouvelles dégradations, comme la retraite par points et « une dose » de capitalisation.
 VAL D’OISE
VAL D’OISE